Ancienneté, ethnicité et authenticité

En Afrique de l’Ouest, les collectionneurs n’utilisent pas les notions d’« art primitif » ou d’« art premier ». Ils leur préfèrent celle d’« art traditionnel » et dans une moindre mesure celle d’« art ancien », ou tout simplement d’« art africain ». À l’imaginaire primitiviste des collectionneurs occidentaux, leurs homologues ouest-africains préfèrent celui de la tradition. L’ancienneté des pièces est moins le signe d’une pureté originelle qu’un lien avec le monde des ancêtres. La collection peut également être vue comme un moyen de se projeter dans l’avenir et de construire un lien avec ses descendants. L’activité de collection est alors conçue comme un outil de sauvegarde culturelle. Un antiquaire ouagalais m’expliquait :
« Dans les villages, il y a des collectionneurs. Ils collectionnent des objets pour garder la culture. Chez les Mossi, tu vas voir qu’il y a la lutte contre l’excision. Alors ceux qui faisaient ça arrêtent. Il y a des vieux qui récupèrent le matériel d’excision et qui gardent ça pour montrer aux petits-enfants comment on faisait. »
Michèle Coquet a insisté sur ces pratiques villageoises :
« Aujourd’hui, l’Afrique villageoise compte des “collectionneurs”, non pas d’objets rares et chers, mais, plus simplement, d’objets de culture. À travers ce geste de conservation, ils ne revendiquent pas la pratique elle-même, qui n’a pas d’existence en tant que telle, mais un statut social, celui de fonctionnaire ou de notable, et un rôle, né par un effet de boomerang de l’attitude occidentale face à ces mêmes objets, de revendications identitaires et de la défense des valeurs traditionnelles » (1999 : 11).
Dans ce contexte, des savoirs peuvent ainsi être transmis en même temps que les objets. C’est en ce sens qu’il faut comprendre la distinction qu’un collectionneur sénégalais établissait entre deux types de collectionneurs : ceux qui collectionnent « par amour », dont la démarche serait avant tout sensible et esthétique, et ceux qui collectionnent « par connaissance », qui accumulent, en même temps que des objets, des savoirs dont « leurs enfants pourront profiter ». Un antiquaire distinguait pour sa part les marchands qui collectionnent pour revendre et les collectionneurs qui rassemblent des objets « pour la sauvegarde culturelle ».
Au Burkina Faso, Maître Titinga Pacere insiste sur l’importance qu’il faut accorder à la transmission des savoirs et explique ainsi la fonction de son musée :
« [Chaque objet du musée de Manega] n’est pas seulement un élément d’exposition, c’est aussi un élément d’instruction, un élément d’enseignement, pour que l’on puisse connaître une culture, et aussi, par voie de conséquence, pour que cette culture ne disparaisse pas. »
La constitution d’une collection est donc souvent pensée comme un moyen de conservation du patrimoine culturel, et l’on retrouve ici l’idée d’une « collecte salvatrice », également avancée par les collectionneurs occidentaux (Derlon et Jeudy-Ballini, 2008 : 244-247). Le discours des collectionneurs oscille ainsi entre celui de la contemplation esthétique et celui de la sauvegarde ethnologique. Des dissonances apparaissent cependant dans les conceptions locales des pratiques de collection. Un antiquaire sénégalais (qui vient de débuter dans le métier) estime qu’en Afrique :
« Il y a beaucoup de collectionneurs, comme autrefois, il y avait un véritable pillage… Les Occidentaux venaient, prenaient les objets et vendaient ça là-bas. Maintenant, les gens connaissent. Ils ne vendent plus facilement. Ils préfèrent garder les objets ou les vendre aux enchères. »
Le collectionneur africain n’est pas seulement perçu ici comme un acteur de la sauvegarde du patrimoine culturel ou artistique au même titre que ses homologues occidentaux. Le fait de conserver ce patrimoine sur place (en contexte) fait toute la différence : les collectionneurs ouest-africains peuvent apparaître comme des figures de la résistance aux marchands d’art occidentaux, accusés d’être des pilleurs. On retrouverait ainsi ici l’« orientation anti-hégémonique » des pratiques de collection en Afrique, soulignée par Ogbechie (2012 : 67).
Il est vrai que la plupart des collectionneurs sont animés par une visée panafricaniste : ils se fixent pour objectif de rassembler des œuvres de toute l’Afrique subsaharienne et de rechercher ce qui est « typiquement africain », pour reprendre l’expression de l’un d’entre eux. Un autre se limite cependant à l’Afrique de l’Ouest pour des raisons de place. Le facteur ethnique se révèle également important, dans une logique d’équivalence entre le style des objets et l’identité ethnique. Ce paradigme hérité de l’anthropologie et constitutif des études consacrées à l’art africain, depuis longtemps dénoncé aussi bien par des historiens de l’art (Kasfir, 1984) que par des ethnologues (Colleyn, 2009 : 734), est réapproprié par les collectionneurs ouest-africains et leur permet tout un jeu d’identification avec les objets de leur collection. Selon ce principe, les collectionneurs accordent un intérêt plus spécifique aux œuvres attribuées à l’ethnie à laquelle ils appartiennent. Une sorte de noyau ethnique peut ainsi être observé dans plusieurs collections. C’est notamment le cas, au Burkina Faso, chez les collectionneurs appartenant à des lignages de chefs traditionnels. Au Sénégal, plusieurs collectionneurs regrettent pour leur part l’inexistence d’un art traditionnel sénégalais ou soulignent la difficulté de se procurer des objets authentiquement sénégalais, en particulier des masques bassari. Les collectionneurs ayant séjourné pendant de nombreuses années dans d’autres pays africains privilégient également la statuaire des groupes ethniques locaux. Avec la crise ivoirienne, plusieurs Burkinabè, « né et grandis » en Côte d’Ivoire et contraints de rentrer dans leur pays d’origine, continuent de collectionner modestement des objets en provenance de Man, de Bouaké ou de Korhogo. D’autres ont laissé leur collection dans leur pays d’origine, chez des parents. Un antiquaire malien qui a ouvert deux galeries à Dakar m’expliquait par exemple avoir conservé une petite collection chez lui, à Bamako. L’attachement au pays peut trouver de la sorte une expression dans les pratiques de collection.
La mise en scène de l’identité du collectionneur est parfois plus subtile. Tel collectionneur sénégalais note posséder plusieurs sculptures figurant des serpents parce qu’il s’agit de son animal totem (mbañ en wolof). La relation totémique, fondée sur l’alliance mythique entre un lignage et une espèce animale, se traduit ainsi par un attachement spécifique aux figurations de l’espèce concernée. Un autre collectionneur, métis, explique pour sa part que la mixité de sa collection, composée à la fois d’œuvres contemporaines et d’objets traditionnels, est le reflet de son propre métissage, de son histoire personnelle. Il la conçoit comme une mise en scène de sa généalogie complexe. Les pratiques de collection révèlent ainsi des logiques de construction ethnique, de localisation géographique ou de projection généalogique.
Mais, pour les collectionneurs ouest-africains comme pour leurs homologues occidentaux (Derlon et Jeudy-Ballini, 2011), le critère de l’authenticité est le plus important. Les antiquaires et les collectionneurs établissent une même classification des objets d’art africain, entre le nyama nyama (des sculptures relevant de traditions récemment inventées, qu’ils qualifient d’« art touristique » ou de « n’importe quoi »), les copies (reproductions d’objets anciens souvent vieillies artificiellement) et les antiquités . Pour reprendre les propos de deux marchands, les objets que l’on trouve sur le marché local vont ainsi du « toc » au « top », de « l’objet » à « la chose ». Les antiquités sont prioritairement recherchées par les collectionneurs, l’ancienneté étant l’un des critères de sélection des objets. L’aspect de l’objet, son usure, sa patine, ses blessures sont autant d’indices visuels de son ancienneté. Mais le risque est grand d’avoir affaire à un faux. La plupart des collectionneurs craignent d’acheter des copies, même si la distinction souvent établie entre bonnes et mauvaises copies sert parfois d’argument pour expliquer leur présence dans leur collection. Un collectionneur burkinabè expliquait par exemple :
« Il y a des pièces qui me plaisent à cause de leur histoire et d’autres parce qu’elles sont belles. Je garde même des copies si elles sont belles. C’est la beauté de la pièce qui est importante. »
À Dakar, un autre m’a montré plusieurs copies dans sa collection. Leur présence constituait pour lui un moyen de suppléer aux difficultés qu’il avait de trouver des pièces identiques mais authentiques. Il avait acquis ces copies en toute connaissance de cause, faute de mieux, en attendant. Le plus souvent cependant, si un collectionneur découvre qu’il possède des copies, il cherche à les revendre. Les objets redeviennent alors des marchandises.
En outre, parmi les pièces anciennes, toutes ne sont pas considérées comme de belles pièces. L’ancienneté est un critère souvent nécessaire mais rarement suffisant. Il faut donc aussi distinguer parmi les objets anciens les « pièces de collection » (certains marchands parlent de « pièces collectionneurs »), en fonction de leur authenticité. On retrouve chez les collectionneurs ouest-africains la même importance accordée à l’usage des objets que chez leurs homologues occidentaux : il ne suffit pas qu’un objet soit ancien, il faut aussi qu’il ait servi. Le récit de l’antiquaire se révèle alors central : ce sont les conditions de la découverte de l’objet qui lui confèrent une certaine authenticité. Son discours participe ainsi à la construction de l’authenticité des objets, conjointement à sa mise en exposition marchande, sur laquelle Steiner a insisté (1994 et 1995).
Plusieurs dispositifs sont en effet utilisés. Tel antiquaire possède deux boutiques, l’une dans laquelle il expose des copies, l’autre réservée aux pièces anciennes. Tel autre possède une galerie dans un « endroit caché », réservé aux collectionneurs. D’autres, nombreux, conservent les pièces anciennes chez eux et invitent leur client à domicile, favorisant à la fois l’intimité des discussions et la discrétion de l’échange marchand. À la galerie comme à la maison, les pièces les plus anciennes sont souvent rangées dans un sac. Les voir est présenté comme un privilège réservé aux connaisseurs. Placer un objet dans un sac constitue également un moyen stratégique de le distinguer et de le singulariser. Il s’agit de produire l’illusion de l’authenticité et de l’unicité. Un antiquaire burkinabè m’expliquait :
« Ce sont des pièces que l’on ne peut pas exposer. Si un client rentre et regarde les pièces d’une certaine manière, on sait qu’on peut lui montrer celles qui sont dans le sac. […] Au bout d’un moment, si un collectionneur vient souvent, tu commences à connaître son goût. Si tu as des pièces que tu penses pouvoir lui vendre, tu ne les exposes pas avec les autres. Tu les mets dans un sac. Ça devient des pièces spéciales. Si tu les mets avec les autres, il ne va même pas les regarder. »
Une seconde explication peut également être donnée à cette technique d’empaquetage, comme l’indiquait un autre marchand burkinabè :
« Certaines pièces anciennes, je sais que c’est pour un collectionneur. Je ne les expose pas. On ne peut pas les exposer. C’est le collectionneur qui va exposer ça chez lui. C’est lui qui décide qui peut voir la chose. »
Le but est donc à la fois de soustraire les objets à la vue de n’importe qui et de laisser le collectionneur choisir qui peut les voir. En ce sens, vendre une œuvre d’art c’est également transmettre à l’acheteur le privilège de décider qui a droit de regard sur elle. Un antiquaire sénégalais parle d’ailleurs de « pièces privées », pour distinguer les objets réservés aux collectionneurs de ceux qui, exposés à la vue de tous, sont destinés aux touristes ou aux clients ordinaires. Avant même l’entrée en collection des objets, certains d’entre eux sont donc privatisés, placés au secret ou du moins gardés à la discrétion du collectionneur.
Ces dispositifs spatiaux et ces mises en réserve, qui participent à la production marchande de l’authenticité des objets d’art africain, se retrouvent dans leur mise en exposition au domicile des collectionneurs. L’un d’entre eux a par exemple rassemblé dans sa chambre les pièces les plus importantes de sa collection (et notamment sa première acquisition). Un autre y conserve les objets qu’il a hérités de son père. Plusieurs emmagasinent les œuvres de plus grande valeur dans des coffres. Dans la région de Kaya, au Burkina Faso, le fils d’un chef de village est à la fois antiquaire et collectionneur. Il a ouvert une galerie à l’entrée du village et garde chez lui sa collection personnelle. Les pièces placées dans son salon sont des copies décoratives tandis qu’il répartit à l’étage, dans une réserve ou dans sa chambre, les objets authentiques. Dans un coin de la concession, à l’abri des regards, les autels du lignage (kiim doogo) reçoivent des sacrifices. Ainsi, en règle générale, plus les objets sont perçus comme authentiques plus ils sont conservés dans l’intimité de l’appartement ou de la concession. Mais plus des objets rituels sont réputés authentiques, c’est-à-dire avoir été utilisés dans un cadre rituel, plus ils risquent de continuer d’être chargés, de se voir attribuer un certain pouvoir. Collectionner de tels objets dans leur contexte socioculturel peut dès lors soulever des problèmes.
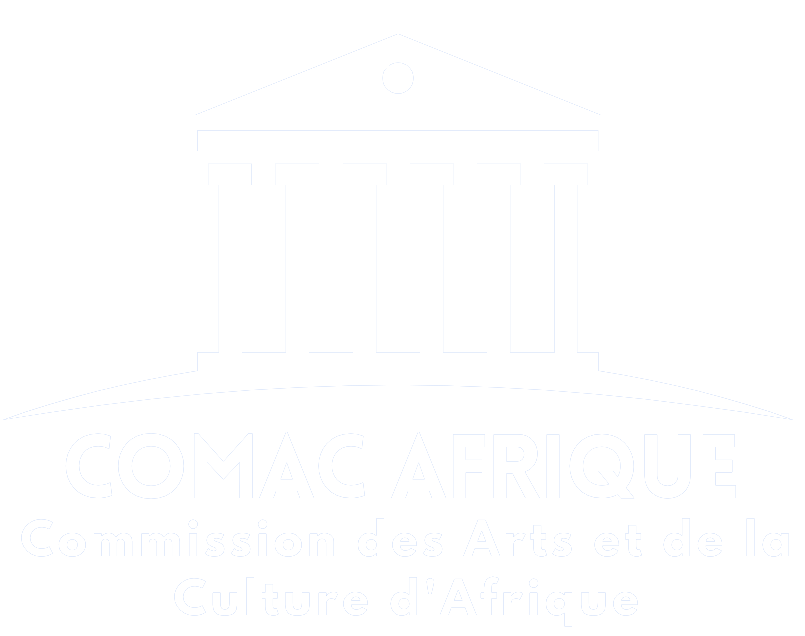
1 Comment
Tres bon articles