Des collections très privées

Enquêter sur les pratiques de collection en Afrique de l’Ouest se révèle délicat à plus d’un titre. Les personnes interrogées insistent soit sur l’absence de « collectionneurs africains », soit sur leur rareté et la difficulté de les rencontrer. À Ouagadougou, les antiquaires déplorent que la crise militaire de 2011 ait fait fuir les collectionneurs expatriés et empêche les collectionneurs burkinabè d’acheter. Au Sénégal, plusieurs personnes affirment que des Sénégalais collectionnent l’art africain mais qu’ils vivent aux États-Unis. Une série de considérations est avancée pour expliquer cette absence ou cette rareté des collectionneurs sur place, parfois exprimées sous la forme d’« invocations culturalistes » (Olivier de Sardan, 1995 : 14) : collectionner les œuvres d’art ne serait pas compatible avec la culture africaine. « Ici, on ne connaît pas la valeur des objets », avance un journaliste. Selon un responsable de musée, l’activité de collection est même considérée comme une anomalie, un comportement qui dérogerait aux normes sociales : « Un collectionneur, quelqu’un qui achète des objets pour les garder, ici on va le prendre pour un fou. » Certains expatriés (parfois relayés par des marchands d’art) stigmatisent, de manière condescendante sinon pire, le mauvais goût des « nouveaux riches » africains, censés préférer le « bling bling », le « tape-à-l’œil » ou le « clinquant » aux formes pures de la statuaire africaine. Une telle opinion sur le jugement de goût des « Africains » est révélatrice des attributions risquées de compétences esthétiques à autrui. Reposant sur des stéréotypes culturalistes, elle légitime une définition discriminante et occidentalocentrée du bon goût : pour certains expatriés, l’absence de collectionneurs africains serait due à une incompétence esthétique culturellement programmée.
Les facteurs économique et religieux fournissent cependant les explications les plus nombreuses. Collectionner est souvent présenté comme une activité réservée aux gens riches, à ce titre plus difficile à imaginer en Afrique. « On préfère acheter à manger plutôt que du bois ! », m’expliquait un Burkinabè. Les difficultés rencontrées pour entrer en contact avec des collectionneurs trouvent là aussi une explication. Non seulement « la manière d’acquérir des objets n’est pas très propre », mais l’origine de l’argent utilisé pour acheter des œuvres d’art est elle-même suspecte. Au Sénégal, on insiste sur la méfiance des collectionneurs dans un contexte postélectoral de « traque des biens mal acquis ». Plusieurs de mes interlocuteurs sénégalais ont d’ailleurs accusé des politiciens collectionneurs d’art africain d’avoir volé des œuvres appartenant à l’État. Tandis que, pour certains, une pauvreté généralisée expliquerait l’inexistence des collectionneurs africains, pour d’autres, c’est l’enrichissement suspect des collectionneurs qui permettrait de comprendre leur invisibilité, ou du moins leur discrétion. « Ils se cachent », résumait l’un des antiquaires les plus connus de Dakar.
La religion constitue enfin le facteur explicatif le plus important parmi ceux proposés pour justifier l’absence ou la rareté des collectionneurs. L’importance des religions révélées au Burkina Faso et au Sénégal est particulièrement mise en avant, mes interlocuteurs insistant sur les interdits liés à l’idolâtrie et, dans le cas de l’islam, sur ceux concernant les images. Le culte des idoles est condamné par le christianisme aussi bien que par l’islam. Pour les musulmans, de nombreux hadiths, diversement interprétés, sont en outre consacrés à la prohibition des images, et plus particulièrement de la figuration d’êtres animés ou de la sculpture : « On a interdit tout ce qui a une ombre et il n’y a aucun mal dans les images qui n’ont pas d’ombre » (Qaradhawi, 2005 : 114). Un collectionneur sénégalais, chrétien, a proposé une série d’explications particulièrement détaillées sur la rareté des collectionneurs. S’appuyant sur une citation attribuée à Senghor (« au Sénégal, il y a 90 % de catholiques, 10 % de musulmans et 100 % d’animistes »), il détaillait les différents aspects des interdits religieux. Le premier interdit, concernant l’idolâtrie, n’était pas valide à ses yeux : « [ceux qui critiquent les collectionneurs] ne comprennent pas que l’art est profane, qu’il ne s’agit pas d’idoles ». Cette insistance sur le caractère profane des collections est revenue à plusieurs reprises au cours de mes enquêtes. Un antiquaire insistait par exemple sur la distinction entre pièce de collection et objet de culte, entre collectionneur et féticheur :
« Un collectionneur, quand il entre dans un magasin, même s’il y a mille objets, il n’en voit qu’un seul. C’est celui-là qu’il achète. Il l’amène chez lui. Ce n’est pas une idole, il ne l’adore pas. Mais il l’admire, il le regarde. »
Le collectionneur sénégalais insistait dans un deuxième temps sur l’interdit concernant dans l’islam la figuration d’êtres animés et, plus encore, celle d’êtres humains : la fabrication et la détention de sculptures anthropomorphes sont toujours considérées comme strictement prohibées. Dans le contexte de l’islam confrérique sénégalais, cet interdit est renforcé par les positions des guides spirituels (cheikhs), très claires à ce sujet. Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de la confrérie mouride, a notamment interdit la statuaire dans toute la région de Touba, capitale de la confrérie. On comprend mieux pourquoi l’un des grands marabouts actuels garde scrupuleusement secrète son activité de collectionneur.
L’idée selon laquelle toute la population sénégalaise demeurerait, au fond, animiste fournit une troisième explication au collectionneur sénégalais qui citait Senghor : « Ils ont toujours peur des objets. Ils ne savent pas comment s’y prendre. » Moins que les interdits religieux visant l’idolâtrie et les figurations anthropomorphes, un certain malaise concernant les objets collectionnés, essentiellement des masques et des statues, permettrait selon lui d’expliquer le caractère exceptionnel des pratiques de collection. Une tension apparaît donc dans les explications fournies par ce collectionneur : en apparence, ses compatriotes critiquent les collectionneurs parce qu’ils les considèrent comme des animistes (aji-gëm-xërëm) ou comme des païens (ceddo ou yéeféer), mais c’est en réalité parce qu’ils possèdent toujours un « fond animiste » qu’ils se méfient des pratiques de collection. La discrétion des collectionneurs s’explique par cette tension constitutive des rapports locaux aux modes de figuration et aux objets. Un responsable de musée le résumait ainsi : « À cause des considérations religieuses, les collections sont toujours très privées ici. ».
L’idée de collections « très privées » est révélatrice d’un problème conceptuel plus général auquel est confronté le chercheur qui s’intéresse aux pratiques de collection privée en Afrique de l’Ouest. Il lui faut s’interroger sur le transfert et donc sur la pertinence analytique de l’opposition entre sphère privée et publique, que sous-entend celle entre collection privée et publique. Le caractère aporétique des études africanistes sur les espaces publics et la relativité de la distinction entre public et privé dans le contexte ouest-africain ont déjà été soulignés par de nombreux chercheurs (Dahou, 2005). Mais de manière générale, ces études portent en priorité sur les espaces publics, et en particulier sur les usages religieux qui en sont faits (on parle alors d’espace public religieux), et non sur les espaces privés. Les pratiques de la collection privée pourraient donc être analysées comme la fabrique ou l’aménagement de tels espaces par les collectionneurs. L’opposition entre public et privé ne trouve cependant pas de traduction évidente dans les langues locales. Mes interlocuteurs lui substituaient une autre distinction entre ce qui est apparent, visible, ce qui se fait « au vu et au su de tout le monde », et ce qui est caché ou secret. Un collectionneur, parlant de sa collection, affirmait par exemple : « Chaque homme a son secret. » En général, les collectionneurs ne se connaissent d’ailleurs pas entre eux, cette absence d’interconnaissance montrant bien que l’existence d’un milieu des collectionneurs en Afrique de l’Ouest est toute relative.
Cette conception de la collection comme une activité intime, discrète et même secrète paraît cependant contredire la volonté de certains collectionneurs d’exposer leurs objets au public. Quelle place accorder aux musées privés, existants ou actuellement en projet, de plusieurs collectionneurs ouest-africains ? Dans le contexte local, les musées privés sont étroitement associés aux musées publics, tant du point de vue ordinaire que dans les discours des agents du patrimoine eux-mêmes. Au Burkina Faso, l’un d’entre eux définissait par exemple le musée de Manega, propriété de Maître Titinga Pacere, un avocat renommé, comme « un musée semi-public ». Il s’agit moins de distinguer les collections publiques et privées que celles qui sont visibles et celles qui sont cachées, une telle distinction s’effectuant sur le même modèle que celui observé au sein des musées entre salles d’exposition et réserves (Bondaz, 2014).
Pour comprendre pourquoi certains collectionneurs entretiennent le plus grand secret sur leurs pratiques et sur leur collection tandis que d’autres au contraire les rendent publiques, parfois de façon ostentatoire, il est nécessaire d’interroger les différents profils des collectionneurs ouest-africains. Un premier groupe de collectionneurs rassemble des personnes instruites et diplômées, financièrement aisées et parfois très fortunées, appartenant à l’élite intellectuelle, politique ou économique de leur pays. La plupart ont des activités qui les conduisent à voyager dans d’autres pays africains, en Europe ou aux États-Unis : ils sont universitaires, magistrats, diplomates, hommes politiques, parfois grands commerçants. Ils soulignent volontiers l’importance qu’ont pu avoir dans leur vocation de collectionneur d’art africain, des visites de musées à l’étranger ou des rencontres avec des figures importantes du marché occidental de l’art africain. Ils s’inscrivent ainsi dans une forme de cosmopolitisme bourgeois caractéristique de la globalisation contemporaine (Hannerz, 1990). Ces collectionneurs sont particulièrement discrets et ne cherchent pas à donner de la visibilité à leur collection.
Un deuxième groupe rassemble les collectionneurs qui appartiennent à des chefferies traditionnelles, plus nombreux au Burkina Faso qu’au Sénégal. Ils rendent généralement publique leur collection en créant des musées privés, dans une logique de légitimation culturelle de leur fonction politique et de valorisation du territoire (sur ce second point, voir Gaugue, 1999). De manière révélatrice, Maître Titinga Pacere rapporte que son envie de collectionner trouve son origine dans un questionnement enfantin directement lié au pouvoir traditionnel. Il est en effet l’un des fils du chef (naaba) de Manega et assiste un jour, très jeune, au rasage de la tête de son père . La conservation des cheveux coupés fonctionne comme une prise de conscience de l’importance des enjeux de préservation. On passe ainsi de la solennité d’un geste à la fois rituel et politique au souci de préserver le patrimoine culturel et artistique moaga, et plus largement africain. Présentées pour la plupart comme des œuvres d’art, les collections du musée de Manega sont exposées selon le modèle des anciens musées ethnographiques ou des écomusées, au sein de dioramas thématiques. Les pavillons d’exposition y côtoient des reconstitutions d’habitats traditionnels.
Cette oscillation entre la mise en valeur esthétique des objets et leur statut de témoins culturels est révélatrice des enjeux liés à ces musées privés. À Bazoulé, un autre village burkinabè, le Naaba Kiiba a récemment ouvert un musée qui présente sa collection personnelle, pour partie héritée de son père. Il s’agit pour lui d’exposer « la culture du village », dans la continuité de l’aménagement touristique de la mare aux crocodiles sacrés qu’il a initié quelques années auparavant. À Gursi, dans une autre région du Burkina Faso, Julien Birigi Ouadraogo qui souhaitait consacrer un musée à la culture gurunsi et y exposer sa collection de masques est décédé avant que le projet ne soit finalisé. Aux Almadies, sur la presqu’île de Dakar, un projet de musée de la culture casamançaise porté par un homme politique diola est en attente. Ces exemples de musées privés, à l’état de projet pour certains, s’inscrivent ainsi dans une logique de visibilité politique, particulièrement nette dans le dernier cas puisqu’il s’agit de valoriser, dans la capitale sénégalaise, la culture d’une région marquée par une rébellion indépendantiste depuis le début des années 1980. Ces projets de musées privés, révélateurs de l’essor de l’entreprenariat culturel en Afrique de l’Ouest, sont par ailleurs souvent perçus par la population comme des moyens de capter des financements de l’État.
Les motivations politiques peuvent également animer le dernier groupe de collectionneurs, qui rassemble des antiquaires et des marchands d’art africain possédant une collection personnelle. S’ils choisissent parfois d’exposer leur collection et d’ouvrir un musée, c’est d’abord dans une logique marchande. Créer un musée privé constitue un bon moyen de valoriser leur activité commerciale, au point que dans certains cas leur galerie jouxte leur musée. Plusieurs interlocuteurs ont d’ailleurs critiqué un tel détournement de la fonction muséale par des marchands d’art.
À Dakar, deux grands antiquaires et collectionneurs, Amadou Yacine Thiam et Mourtala Diop, apparaissent comme des modèles de réussite. Ils sont tenus pour des modoumodou, des Sénégalais peu instruits et partis de rien, qui ont commencé à vendre quelques objets avant de devenir des marchands renommés puis de commencer eux-mêmes à collectionner. Tous deux ont vécu pendant plusieurs années aux États-Unis avant de revenir s’installer au Sénégal. Le premier a ouvert à Dakar le Yacine Art Center, également nommé Keur Gaindé (la « maison du lion », en wolof), en référence au lion gigantesque qui coiffe l’architecture du bâtiment. Le second a bénéficié d’une reconnaissance plus grande encore. Sa riche collection personnelle de masques et de statues d’Afrique centrale est l’une des rares collections africaines qui aient fait l’objet d’une publication. En 1995, Francine Ndiaye, responsable du département Afrique noire au musée de l’Homme, lui a consacré un catalogue, justement titré Emblèmes du pouvoir (Ndiaye, 1995). Mourtala Diop est également présenté comme un mécène (Derey et Hahn, 1993) : il a en effet constitué une importante collection d’art contemporain internationale, en échangeant de nombreuses œuvres d’art traditionnel africain contre celles d’artistes contemporains renommés qu’il comptait comme clients, au premier rang desquels Arman. Tout en poursuivant son activité de marchand, Diop a récemment ouvert un grand musée à Saly, station située sur la Petite-Côte sénégalaise très fréquentée par les Européens.
Appelé musée Xelcom, il comporte un parc de sculptures contemporaines monumentales (qui héberge également une petite collection de voitures anciennes), un rez-de-chaussée consacré à l’art contemporain et un premier étage dédié à « l’art africain », avec des pièces anciennes provenant pour l’essentiel du Nigeria et d’Afrique centrale. Au rez-de-chaussée, à côté des toiles d’artistes de toutes nationalités, trois grandes photographies accueillent le visiteur. Les deux premières sont celles de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride, et de son fils Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife de Touba, le marabout auquel Diop a fait allégeance. La troisième, prise lors de l’inauguration du musée le 18 mai 2011, est celle d’Abdoulaye Wade. Le président de la République du Sénégal l’a dédicacée : « À Mourtala Diop, artiste et collectionneur, avec mes sentiments attentifs et patriotiques. » Le témoignage de l’allégeance religieuse voisine ainsi avec celui des amitiés politiques. Toute référence à l’activité marchande du collectionneur est occultée.
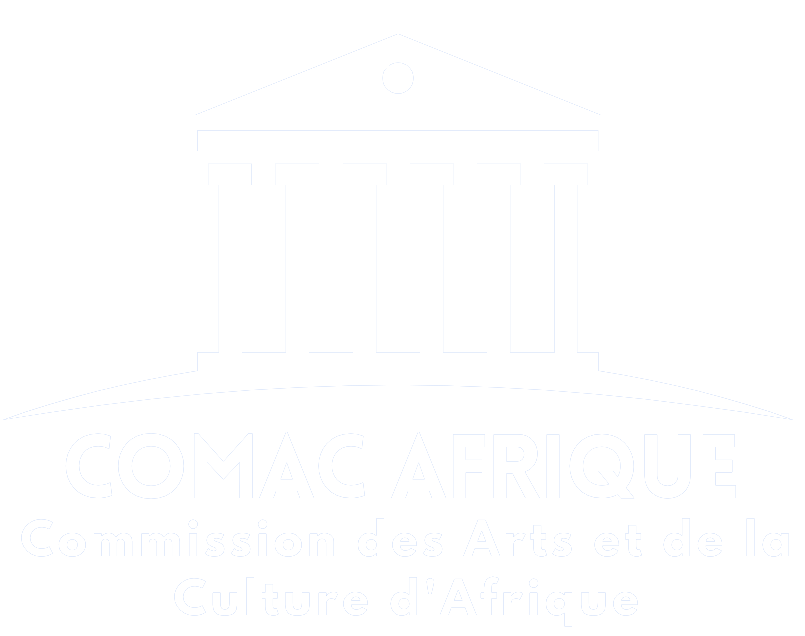
1 Comment
La Comac devrait mettre enfin le projet CAIVEA en route pour indemniser les victimes d’escroqueries à l’art